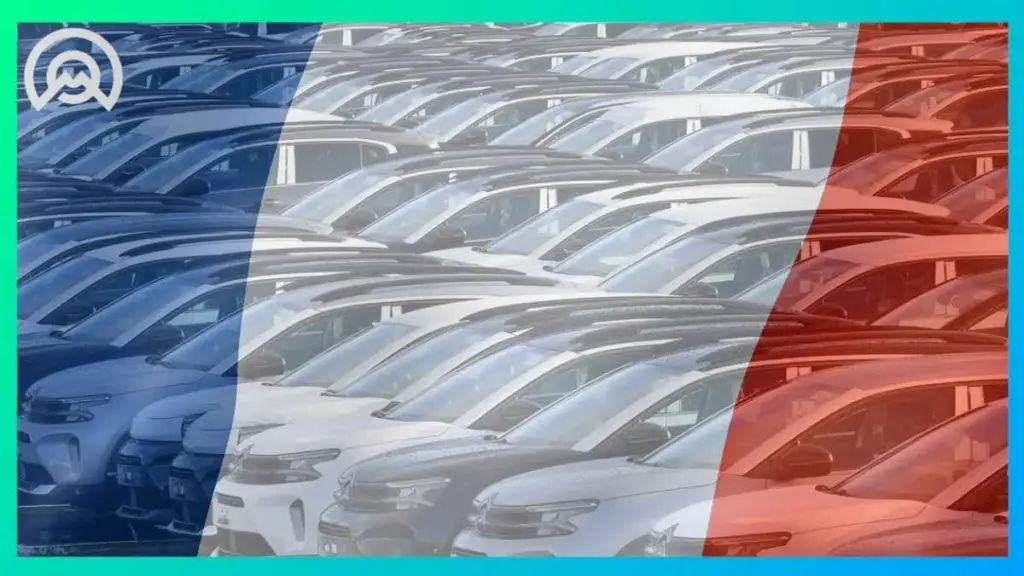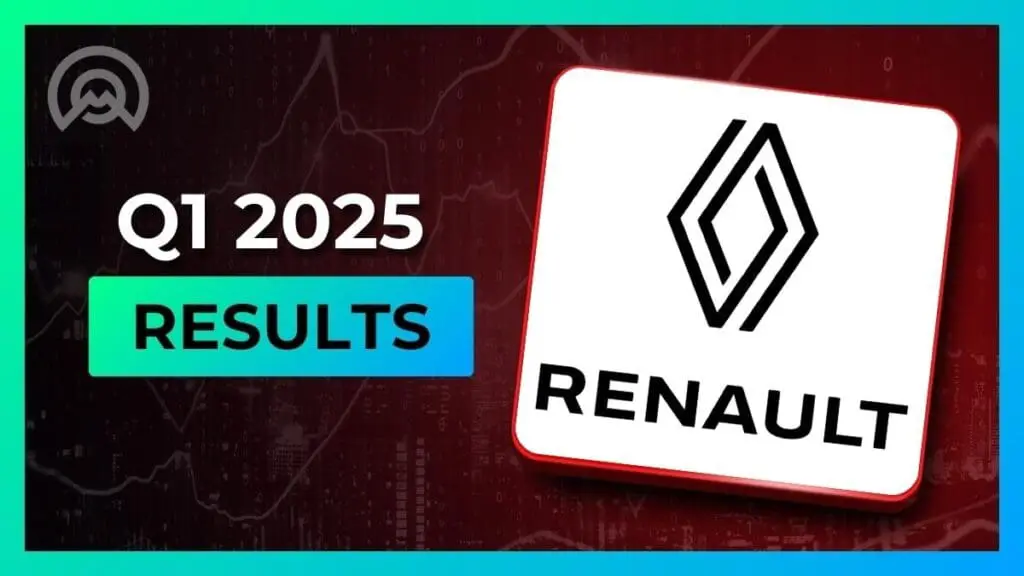Résumé :
- 15 grands constructeurs automobiles et l’ACEA condamnés à 458 millions d’euros d’amendes pour entente illicite
- Le cartel a fonctionné pendant plus de 15 ans, du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017
- Mercedes-Benz a échappé à l’amende en dénonçant l’existence du cartel aux autorités européennes
- Les constructeurs ont délibérément caché des informations sur le recyclage de leurs véhicules aux consommateurs
- Volkswagen écope de la plus lourde sanction avec 127,69 millions d’euros d’amende
Les grandes marques automobiles européennes sont secouées par le scandale d’une entente illicite impliquant leurs plus grands noms. La Commission européenne a révélé le 1er avril 2025 qu’un groupe réunissant 15 fabricants et leur association professionnelle avait dissimulé leurs véritables pratiques de recyclage pendant plus d’une décennie. Ces entreprises avaient établi entre elles un pacte de silence sur tout ce qui touchait au recyclage et à la seconde vie des matériaux.
Cette situation montre comment ces sociétés ont empêché toute concurrence sur le plan écologique et caché aux acheteurs des informations essentielles sur l’impact de leurs véhicules sur la planète. Une stratégie concertée qui vient de leur coûter 458 millions d’euros. Cette sanction risque de bouleverser en profondeur les règles du jeu dans un secteur qui peine déjà à s’adapter aux nouvelles exigences environnementales. Ce scandale met en lumière les contradictions d’une filière qui communique abondamment sur ses engagements verts tout en dissimulant ses pratiques réelles.
Le pacte secret qui a paralysé l’innovation écologique dans l’automobile
Comment l’ACEA a orchestré le plus grand cartel de l’histoire automobile
Le scandale qui ébranle le marché des véhicules est d’une ampleur rarement vue. BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Opel, Renault/Nissan, Stellantis, Volkswagen, Toyota, et Volvo, ainsi que l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), sont tous dans le collimateur de la Commission européenne. La liste comprend pratiquement tous les acteurs majeurs en Europe, ce qui révèle l’étendue systémique de ces pratiques.
Ces entreprises sont accusées d’avoir participé à une coalition qui s’est étendue du 29 mai 2002 au 4 septembre 2017. Pendant ces 15 années, elles ont coordonné leurs actions concernant le recyclage des véhicules hors d’usage. Cette période couvre une phase où les réglementations écologiques se sont progressivement durcies en Europe, rendant cette entente d’autant plus dommageable pour les avancées en matière de protection de l’environnement.
L’ACEA, censée représenter les intérêts des marques, a en réalité joué un rôle de « facilitateur » dans ce réseau, en organisant des réunions entre les différents acteurs et en permettant ainsi la mise en place de ces pratiques anticoncurrentielles. Ce double jeu est particulièrement préoccupant car l’association est souvent considérée comme un interlocuteur légitime par les instances européennes lors de l’élaboration des réglementations.
Les marques les plus impliquées dans cette coalition comprennent :
- Renault, qui a participé du début à la fin de l’entente
- Stellantis, dont plusieurs marques étaient impliquées avant même la fusion
- Toyota, pourtant souvent mis en avant pour ses initiatives écologiques
- Volvo, qui cultive une image axée sur la responsabilité
- Opel, présent dans toutes les phases de l’entente
Toutes ont participé à ce pacte de bout en bout, montrant leur engagement total dans ces pratiques interdites. L’enquête a révélé une coordination méticuleuse entre ces acteurs, avec des échanges réguliers d’informations et des stratégies communes pour maintenir l’opacité sur leurs méthodes de recyclage.
Pourquoi Mercedes a choisi de parler
Dans ce dossier, Mercedes-Benz a joué un rôle inattendu. Bien qu’ayant participé aux pratiques du groupe, la firme allemande a finalement révélé son existence aux autorités européennes. Ce changement de cap lui a permis d’éviter une amende de 35 millions d’euros, grâce au programme de clémence de la Commission européenne qui récompense les entreprises dénonçant les ententes illicites.
Cette révélation pourrait s’expliquer par un repositionnement de Mercedes-Benz sur le marché ou par des changements internes de direction. La marque allemande, qui cherche à se positionner comme un leader de la mobilité électrique premium, avait peut-être intérêt à se démarquer de ces pratiques obsolètes. Il est aussi possible que des responsables internes aient alerté sur les risques juridiques et d’image liés à la poursuite de cette collaboration secrète.
Quelle que soit sa motivation, cette décision a forcé les autres firmes à reconnaître leur culpabilité face aux preuves apportées. La trahison de Mercedes-Benz a provoqué un effet domino, contraignant les autres membres du groupe à adopter une stratégie de collaboration avec les autorités pour limiter les dégâts financiers et d’image. Cette situation illustre parfaitement la fragilité inhérente aux ententes illicites, où l’intérêt individuel finit souvent par l’emporter sur la collusion.
Le silence organisé qui a trompé des millions de consommateurs européens
Un accord de silence sur les pratiques de recyclage
Au cœur du problème se trouve un pacte nuisible pour les consommateurs et la planète. Selon Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission européenne, les firmes impliquées ont choisi de :
« ne pas se concurrencer sur la publicité concernant le degré de recyclage de leurs voitures ».
Cette stratégie a empêché l’émergence d’une saine émulation qui aurait pu faire progresser les pratiques de l’ensemble du marché.
Par ailleurs, ces grandes marques ont gardé « le silence sur les matériaux recyclés utilisés dans leurs nouvelles voitures« . Ce manque de transparence a privé les acheteurs d’informations qui auraient pu influencer leurs choix, dans un contexte où l’intérêt pour l’écologie prend une place grandissante. Les consommateurs européens, de plus en plus sensibles aux questions de protection de la nature, ont été maintenus dans l’ignorance des réelles performances des véhicules en matière de recyclage.
Les comportements problématiques des fabricants incluaient :
- Le partage d’informations confidentielles sur leurs accords avec les entreprises de recyclage
- L’absence délibérée de communication sur leurs taux de recyclage
- La suppression de toute concurrence sur les performances écologiques
- Le maintien d’une opacité sur l’utilisation de matériaux recyclés
- L’établissement de stratégies communes pour répondre aux obligations réglementaires au moindre coût
Cette coalition a permis aux entreprises de présenter un front uni face aux réglementations européennes, limitant ainsi l’efficacité des politiques publiques en matière de recyclage des véhicules. En s’accordant sur des pratiques minimales communes, elles ont empêché l’apparition d’acteurs plus vertueux qui auraient pu tirer le marché vers le haut et accélérer l’adoption de meilleures normes écologiques.
Comment les géants de l’automobile ont sacrifié la filière du recyclage
L’enquête a mis en lumière des pratiques douteuses concernant les relations entre fabricants et sociétés de démontage. Les membres de l’entente se sont accordés pour ne pas payer correctement ces sociétés, exerçant ainsi une pression financière sur un maillon essentiel de la chaîne de recyclage. Cette pression s’est traduite par des contrats défavorables et des tarifs artificiellement bas imposés à ces entreprises.
Cette méthode a eu des effets négatifs sur toute la filière. En refusant de payer à leur juste valeur ces services, les grands groupes ont freiné les investissements dans ce domaine, ralentissant l’amélioration des techniques de recyclage. Les entreprises de démontage, confrontées à cette pression économique, n’ont pas pu développer pleinement leurs capacités d’innovation ni améliorer leurs procédés.
Cette situation a créé un cercle vicieux : sans rémunération adéquate, les entreprises de démontage n’ont pas pu investir dans des technologies permettant un meilleur taux de recyclage, ce qui a servi d’alibi aux fabricants pour justifier la faible proportion de matériaux recyclés dans leurs véhicules neufs. Un mécanisme pervers qui a contribué à ralentir la transition vers une économie plus circulaire dans le monde des transports.
Par ailleurs, ce pacte a créé des distorsions de concurrence au sein même du domaine du recyclage, favorisant les entreprises qui acceptaient les conditions désavantageuses imposées par le groupe au détriment d’acteurs potentiellement plus efficaces ou innovants. Les retombées se font donc sentir bien au-delà des seuls fabricants de voitures.
458 millions d’euros : le prix à payer pour avoir trompé l’Europe
Des amendes records pour punir 15 ans de tromperie organisée
Face à la gravité et à la durée de ces pratiques, la Commission européenne a infligé des amendes totalisant 458 millions d’euros. Ce montant, bien que conséquent, représente une fraction du chiffre d’affaires des entreprises concernées, tout en étant suffisamment significatif pour envoyer un message fort au marché. Voici comment se répartissent ces sanctions :
| Fabricant | Montant de l’amende (millions €) | Part du total (%) |
| Volkswagen | 127,69 | 27,9% |
| Renault/Nissan | 81,46 | 17,8% |
| Stellantis | 74,93 | 16,4% |
| BMW | 24,58 | 5,4% |
| Toyota | 23,55 | 5,1% |
| Autres marques | 125,79 | 27,4% |
| Mercedes-Benz | 0 (immunité) | 0% |
La répartition de ces amendes reflète à la fois la taille des entreprises, leur degré d’implication dans l’entente et leur chiffre d’affaires. Volkswagen, premier groupe européen, écope logiquement de la sanction la plus lourde, tandis que des acteurs de taille intermédiaire comme BMW ou Toyota se voient infliger des amendes plus modérées.
Ces montants ont été réduits de 10% suite à la reconnaissance de culpabilité des entreprises. Cette réduction, même modeste, montre la volonté des autorités d’encourager la coopération des acteurs économiques, même après la découverte d’infractions. Cette politique vise à accélérer les procédures et à faciliter la mise en œuvre des sanctions, tout en incitant les firmes à adopter une attitude plus transparente.
L’exemption totale dont bénéficie Mercedes-Benz illustre l’efficacité du programme de clémence européen, qui constitue un puissant incitatif à la dénonciation des ententes illicites. Sans cette possibilité d’immunité, il est probable que la collusion aurait pu se poursuivre encore plusieurs années, continuant à nuire aux consommateurs et à la planète.
La Commission européenne frappe fort : l’ère de l’impunité écologique est révolue
La réponse de la Commission européenne à ce dossier montre sa détermination à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, surtout quand elles nuisent aux objectifs écologiques de l’Union. Cette situation marque une évolution notable dans l’application du droit de la concurrence, qui prend désormais en compte les dimensions vertes des comportements anticoncurrentiels.
Teresa Ribera a exprimé clairement cette position en déclarant :
« Nous ne tolérerons aucune entente, y compris celles qui réduisent la sensibilisation des clients et leur demande de produits plus respectueux de l’environnement ».
Cette déclaration souligne que la Commission considère désormais l’information écologique comme un élément essentiel de la concurrence, au même titre que les prix ou les caractéristiques techniques des produits.
Ce cas crée un précédent en sanctionnant non seulement les accords sur les prix, mais aussi ceux qui limitent la transparence en matière de performances écologiques. Il traduit une vision plus intégrée des politiques européennes, où concurrence et protection de la nature ne sont plus traitées comme des domaines distincts mais comme des préoccupations complémentaires.
Pour les fabricants de voitures, déjà confrontés à la transition énergétique et aux nouvelles normes d’émissions, ces sanctions représentent un signal fort. Les groupes devront désormais respecter strictement les règles de concurrence dans leurs méthodes écologiques, sous peine de lourdes amendes. Cette décision pourrait accélérer la transition vers des pratiques plus transparentes et plus respectueuses de la planète, dans une filière qui pèse lourd dans l’empreinte carbone européenne.
Cette sanction pourrait avoir des répercussions sur d’autres marchés industriels où des pratiques similaires pourraient exister, incitant les entreprises à revoir leur vision de la concurrence écologique. Les autorités européennes montrent ainsi qu’elles sont prêtes à utiliser tous les outils à leur disposition pour faire avancer leurs objectifs climatiques et de préservation de l’environnement.