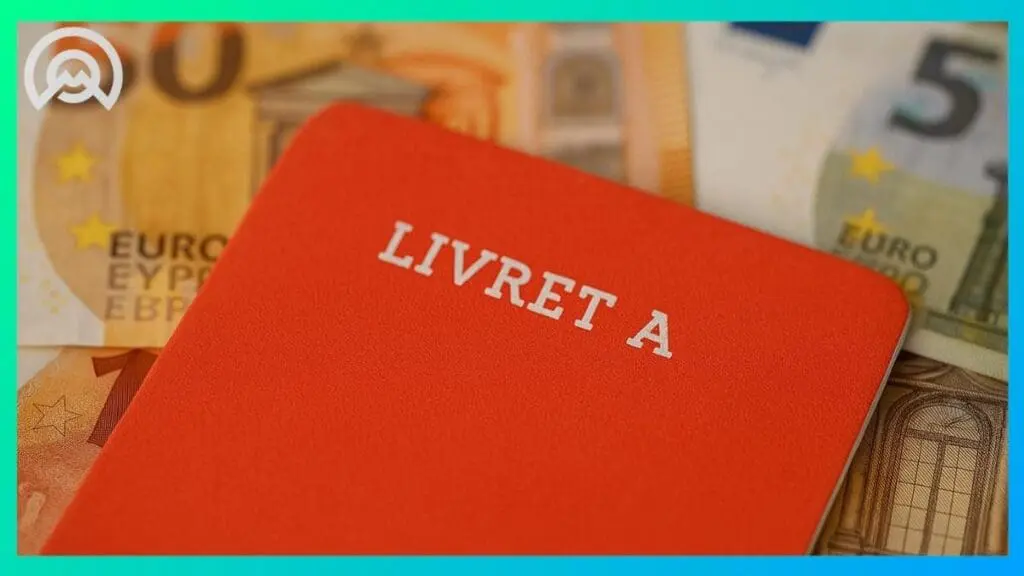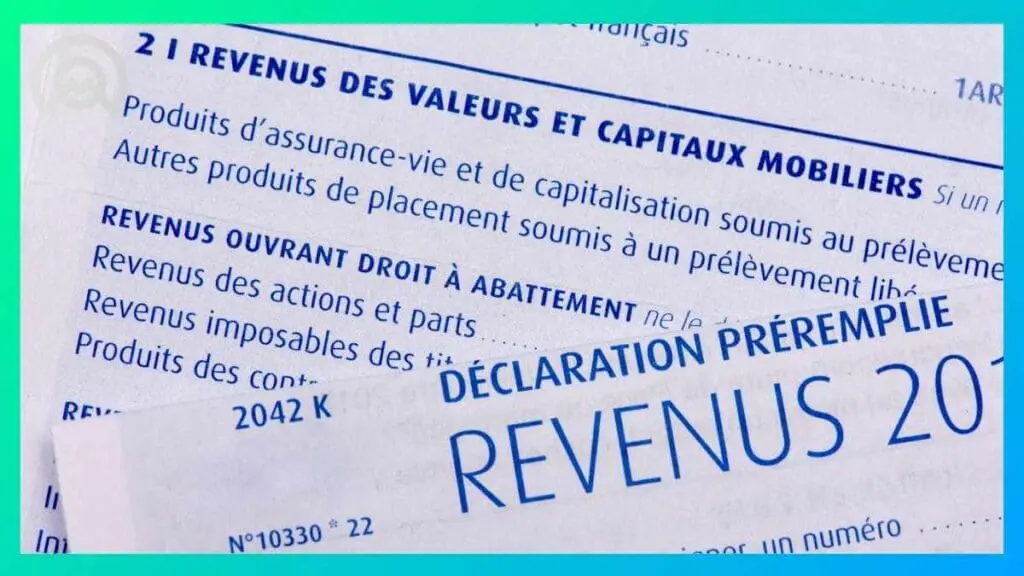Résumé :
- Dès 2026, les véhicules classés Crit’Air 2 commenceront à être interdits dans certaines villes françaises
- Le nombre de Zones à Faibles Émissions (ZFE) passera de 25 à potentiellement 42 villes l’année prochaine
- Lyon, Montpellier, Strasbourg et Grenoble ont déjà annoncé l’interdiction progressive des véhicules Crit’Air 2
- Les modèles concernés incluent les véhicules essence immatriculés entre 2006 et 2010 et les diesels immatriculés depuis 2011
- Des exemptions existent pour certains usagers, notamment les titulaires d’une carte mobilité inclusion
La lutte contre la pollution atmosphérique franchit une nouvelle étape décisive en France avec l’expansion rapide des Zones à Faibles Émissions (ZFE) et le durcissement considérable des restrictions liées aux vignettes Crit’Air. Cette politique environnementale ambitieuse bouleverse déjà le quotidien de nombreux automobilistes, mais les changements les plus significatifs restent à venir.
Après avoir progressivement banni les véhicules les plus anciens et polluants (Crit’Air 3, 4, 5 et non classés), les autorités françaises s’apprêtent à cibler des voitures bien plus récentes. En effet, dès 2026, les véhicules arborant la vignette Crit’Air 2 – jusqu’ici considérés comme relativement acceptables sur le plan environnemental – commenceront à rencontrer des limitations de circulation dans plusieurs grandes agglomérations.
Cette nouvelle phase réglementaire, qui concerne des automobiles parfois acquises il y a moins de dix ans, suscite inquiétude et incompréhension chez des millions de propriétaires français qui s’interrogent sur l’avenir de leur mobilité quotidienne.
Le système Crit’Air : un dispositif en constante évolution
Lancées en 2016, les vignettes Crit’Air constituent désormais un pilier fondamental de la stratégie environnementale française. Bien au-delà d’un simple autocollant décorant les pare-brises, ces certificats de qualité de l’air révolutionnent concrètement la mobilité urbaine. Le dispositif catégorise les véhicules en six classes distinctes, identifiables par leurs couleurs caractéristiques, selon leur impact sur la qualité de l’air.
La vignette verte (Crit’Air 0) récompense les véhicules électriques et à hydrogène, tandis que la violette (Crit’Air 1) distingue les hybrides rechargeables et les modèles essence immatriculés depuis janvier 2011. La jaune (Crit’Air 2) englobe les diesels enregistrés depuis 2011 et les essences depuis 2006. Les catégories suivantes – orange (Crit’Air 3), bordeaux (Crit’Air 4) et grise (Crit’Air 5) – classifient les véhicules progressivement plus anciens et polluants.
Ce qui transforme ce système en puissant levier de changement, ce sont les Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m). Imposées par la loi Climat et Résilience de 2021, ces zones doivent apparaître dans toutes les agglomérations dépassant 150 000 habitants avant fin 2024. Par conséquent, le paysage urbain français s’engage dans une métamorphose sans précédent.
Dès janvier 2025, la vignette Crit’Air deviendra obligatoire dans 25 métropoles françaises, et ce chiffre pourrait bondir à 42 l’année suivante. Des agglomérations comme Amiens, Angers, Brest, Caen ou Dijon rejoindront ainsi le mouvement déjà initié par Paris, Lyon, Marseille ou Strasbourg. Cette propagation fulgurante illustre l’accélération des politiques publiques visant à purifier l’air de nos centres urbains.
Millions de Français concernés : ces voitures que vous ne pourrez bientôt plus conduire en ville
Si 2025 marque déjà un tournant crucial avec le bannissement des véhicules Crit’Air 3 dans plusieurs zones, notamment dans la Métropole du Grand Paris, 2026 s’annonce comme l’année décisive pour des millions d’automobilistes français. Cette échéance inaugurera les premières restrictions ciblant les véhicules Crit’Air 2, jusqu’alors majoritairement épargnés.
Cette évolution réglementaire affecte des automobiles étonnamment récentes : les modèles essence aux normes Euro 4 immatriculés entre 2006 et 2010, les diesels aux normes Euro 5 et 6 enregistrés à partir de 2011, ainsi que les deux-roues aux normes Euro 3. Pour de nombreux propriétaires, le choc s’avère considérable, puisqu’il s’agit fréquemment de véhicules acquis il y a moins de 15 ans, parfois même moins de 10 ans pour certains diesels.
Calendrier d’interdiction des Crit’Air 2 par ville
| Ville | Date prévue | Véhicules concernés | Restrictions particulières |
| Lyon | 2028 | Diesel en priorité | Restrictions progressives depuis le centre-ville |
| Montpellier | 2028 | Diesel en priorité | Interdiction dans le cœur métropolitain |
| Strasbourg | 2028 | Tous Crit’Air 2 | Application sur l’ensemble de l’Eurométropole |
| Grenoble | Avant 2030 | Tous Crit’Air 2 | Zone d’exclusion correspondant à la ZFE actuelle |
| Paris | Non annoncé | Non précisé | Potentiellement après 2027 |
| Marseille | Non annoncé | Non précisé | Étude d’impact en cours |
| Bordeaux | Non annoncé | Non précisé | Consultation citoyenne prévue |
| Toulouse | Non annoncé | Non précisé | Réflexion engagée |
Plusieurs métropoles ont déjà dévoilé leur calendrier d’interdiction des Crit’Air 2. Lyon et Montpellier projettent d’appliquer cette mesure en 2028, initialement uniquement pour les diesels. Strasbourg adoptera également cette restriction en 2028, tandis que Grenoble l’envisage avant 2030. Bien que ces échéances puissent paraître lointaines, elles révèlent une tendance lourde que d’autres municipalités pourraient adopter, potentiellement avec des délais plus courts.
Pour les contrevenants, les pénalités s’avèrent dissuasives. Circuler sans vignette Crit’Air dans une ZFE ou ignorer les restrictions en vigueur expose à des amendes significatives. Néanmoins, ces limitations ne s’appliquent généralement pas en permanence. Dans le Grand Paris, par exemple, elles sont actives en semaine de 8h à 20h, mais suspendues les week-ends et jours fériés, offrant ainsi une certaine flexibilité aux usagers occasionnels.
Aides financières, dérogations, alternatives : comment s’adapter face au tsunami des ZFE
Face à cette révolution annoncée, les automobilistes concernés doivent anticiper et élaborer des stratégies d’adaptation. L’option la plus évidente consiste naturellement à remplacer son véhicule par un modèle moins polluant. Toutefois, cette solution implique un investissement substantiel que tous ne peuvent pas supporter.
Heureusement, divers dispositifs d’aide existent pour faciliter cette transition. Les primes à la conversion et le bonus écologique représentent des soutiens financiers substantiels pour l’acquisition d’un véhicule plus respectueux de l’environnement. Parallèlement, de nombreuses collectivités locales proposent des subventions complémentaires pour encourager l’abandon des véhicules polluants au profit d’alternatives plus écologiques.
Les transports collectifs, le covoiturage, l’autopartage ou encore les mobilités douces (vélo, trottinette) constituent également des solutions viables, particulièrement pour les déplacements urbains. L’expansion du télétravail offre par ailleurs une réponse indirecte permettant de diminuer les besoins en déplacements quotidiens.
Il existe également des dérogations aux restrictions de circulation. Les détenteurs d’une carte mobilité inclusion bénéficient d’exemptions, tout comme certains professionnels dont l’activité nécessite impérativement l’utilisation d’un véhicule. Ces exceptions, variables selon les territoires, méritent d’être explorées par les personnes impactées.
Enfin, pour les habitants des zones périurbaines insuffisamment desservies par les transports en commun, la problématique demeure particulièrement aiguë. Des mécanismes d’adaptation plus progressifs pourraient être instaurés pour ces populations, ainsi que des solutions de rabattement vers les principaux nœuds de transport collectif.