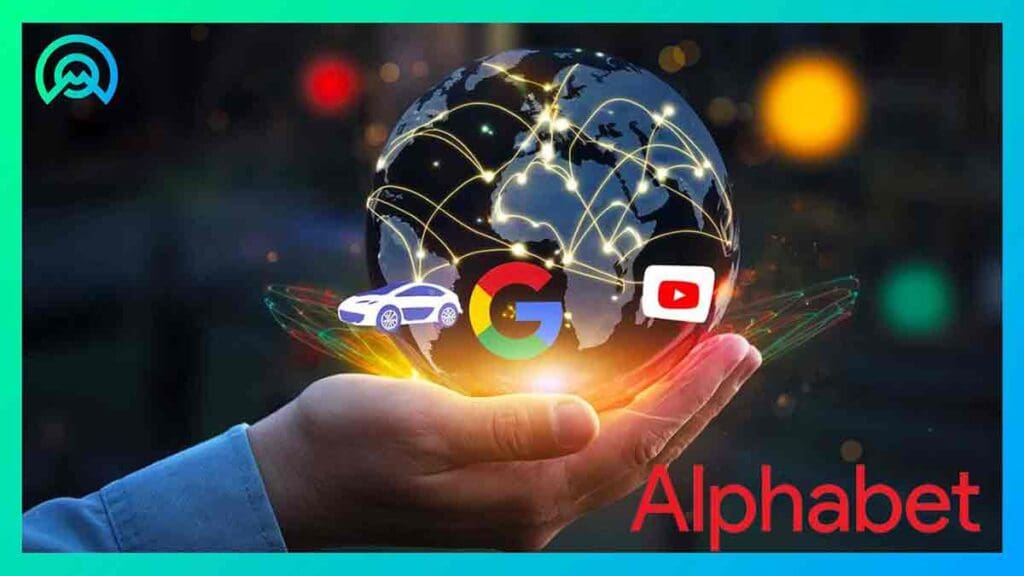Résumé :
- Google risque de perdre Chrome et Android suite à sa condamnation pour monopole
- L’entreprise verse 26 milliards de dollars par an pour être le moteur par défaut
- Le PDG Sundar Pichai défend personnellement son groupe devant le juge
- Les revenus publicitaires de Google atteignent 53 milliards au dernier trimestre
- La décision pourrait transformer l’internet que nous utilisons quotidiennement
Washington est devenu l’épicentre d’un séisme judiciaire. Depuis le 21 avril 2025, le tribunal fédéral de Columbia accueille l’affrontement entre Google et la justice américaine – une bataille sans précédent où le géant de Mountain View, après avoir été déclaré coupable de monopole en 2024, pourrait être contraint de céder Chrome et Android. Cette décision du juge Amit Mehta représenterait le plus grand démantèlement technologique de l’histoire récente et affecterait directement les milliards d’utilisateurs qui dépendent quotidiennement des services de Google, tout en rebattant complètement les cartes du pouvoir au sein de la Silicon Valley.
Les enjeux dépassent largement le simple avenir d’une entreprise, aussi puissante soit-elle. Cette affaire oppose deux visions radicalement différentes : d’un côté, celle du Département de Justice qui considère que la domination écrasante de Google (90% des recherches en ligne) étouffe l’innovation et limite les choix des consommateurs ; de l’autre, celle d’un géant technologique qui estime que sa position dominante est le fruit de la qualité de ses produits et des investissements colossaux (26 milliards de dollars annuels) qu’il a consentis pour s’imposer comme moteur de recherche par défaut. Au-delà de Google, c’est tout le modèle économique des géants du numérique, basé sur la collecte massive de données et la publicité ciblée, qui se trouve aujourd’hui dans le collimateur des régulateurs américains.
L’argent roi : comment Google a acheté sa domination
Les contrats d’exclusivité qui ont changé l’internet
Au cœur de cette bataille juridique se trouve une pratique commerciale qui a façonné notre usage quotidien d’internet. Pendant près de vingt ans, Google a versé des sommes colossales – dépassant 26 milliards de dollars annuels – à des partenaires comme Apple, Samsung et Mozilla. Le but ? S’assurer que son moteur de recherche soit l’option par défaut sur leurs navigateurs et appareils.
Ces accords ont offert à Google une position sans rival. Quand un utilisateur allume son nouvel iPhone ou son smartphone Samsung, le moteur de recherche préinstallé est automatiquement celui de Google. Cette méthode a parfaitement fonctionné : l’entreprise détient aujourd’hui plus de 90% des recherches en ligne aux États-Unis et dans le monde.
La domination de Google en chiffres
| Indicateur | Valeur | Impact concurrentiel |
| Part du marché mondial des recherches | Plus de 90% | Accès limité pour les concurrents |
| Montant annuel des contrats d’exclusivité | 26 milliards $ | Barrière financière insurmontable |
| Revenus trimestriels (fin 2024) | 53 milliards $ | Puissance financière disproportionnée |
| Valorisation estimée de Chrome | 15-20 milliards $ | Actif stratégique majeur |
| Part de marché d’Android | Plus de 70% | Contrôle de l’accès mobile à internet |
Une machine à profits bien huilée
Cette mainmise n’est pas juste une question de prestige. Elle forme la base même du modèle économique de Google. En captant la grande majorité des recherches en ligne, la firme a accumulé une quantité impressionnante de données sur les comportements des internautes.
Ces informations permettent à Google de vendre aux annonceurs des publicités ciblées extrêmement efficaces, source de revenus gigantesques. Le dernier trimestre 2024 le confirme avec 53 milliards de dollars de recettes, essentiellement issues de la publicité. Google investit donc massivement dans ces contrats d’exclusivité : ils garantissent son monopole et alimentent sa machine à profits.
Privés d’oxygène : le sort des alternatives à Google
Dans l’ombre de cette stratégie, des moteurs comme Microsoft Bing ou DuckDuckGo ont peiné à simplement exister. Malgré des investissements importants et parfois des approches novatrices, ces alternatives n’ont jamais pu vraiment défier Google.
L’explication est simple : sans accès direct aux utilisateurs, ces moteurs de recherche n’ont pas pu recueillir assez de données pour améliorer leurs algorithmes au même rythme que Google. Un cercle vicieux s’est installé : moins d’utilisateurs signifiait moins de données, entraînant des résultats de recherche moins pertinents, ce qui repoussait encore plus les utilisateurs potentiels.
Face au juge Mehta : Google joue sa survie à Washington
La sentence de l’été 2024 : Google reconnu coupable
« Google est un monopole et a œuvré pour maintenir son monopole. » Cette phrase du juge Amit Mehta à l’été 2024 a secoué la Silicon Valley. Pour la première fois, la justice américaine reconnaissait officiellement que le champion de la recherche en ligne avait enfreint les règles de la concurrence.
Ce n’était que le début d’une procédure complexe. Maintenant que la culpabilité est établie, le tribunal doit déterminer quelles sanctions imposer pour rétablir une concurrence saine sur le marché de la recherche en ligne. C’est exactement l’enjeu des audiences débutées le 21 avril 2025.
Des sanctions sans précédent
Parmi les solutions proposées par le Département de la Justice américain, certaines sont particulièrement sévères. La plus spectaculaire vise la vente forcée de Chrome, le navigateur web de Google, qui représente aujourd’hui le principal accès à son moteur de recherche.
Les procureurs vont plus loin en demandant également que Google cède Android, son système d’exploitation mobile qui équipe plus de 70% des smartphones dans le monde. Une telle mesure constituerait un démantèlement jamais vu dans l’histoire des technologies modernes.
D’autres options sont aussi envisagées : interdire à Google de signer des contrats d’exclusivité, l’obliger à partager ses données avec ses concurrents, ou lui interdire d’associer son moteur de recherche à d’autres services comme son IA Gemini.
Chrome et Android : les piliers menacés
Si Google se bat avec tant d’énergie, c’est que Chrome et Android sont bien plus que de simples produits. Ils constituent les fondements de son empire numérique et ses principales sources de collecte de données.
Chrome, estimé entre 15 et 20 milliards de dollars selon Bloomberg, n’est pas seulement le navigateur le plus populaire au monde. Il fonctionne aussi comme un puissant collecteur d’informations sur les habitudes de navigation, données essentielles pour perfectionner les algorithmes de recherche et affiner le ciblage publicitaire.
Quant à Android, sa valeur est inestimable pour Google. En équipant la plupart des smartphones mondiaux, ce système garantit à l’entreprise un accès privilégié au marché mobile en pleine expansion. Surtout, il lui permet d’installer ses applications et services – notamment son moteur de recherche – comme options par défaut sur des millions d’appareils.
La défense du géant : entre concessions et contre-attaque
La carte de l’IA et des nouveaux rivaux
Face à ces accusations, Google mise sur l’apparition de nouveaux types de concurrence. L’entreprise souligne la montée en puissance d’alternatives comme ChatGPT d’OpenAI ou Perplexity, qui changent la façon dont les gens cherchent de l’information en ligne.
Ces outils d’IA représentent, selon Google, une menace directe pour sa méthode classique de recherche. L’argument est clair : comment parler de monopole quand de nouveaux acteurs transforment le marché avec des technologies différentes ? Pour appuyer cette idée, des responsables de ces startups ont d’ailleurs été appelés à témoigner par l’accusation.
Le patron en première ligne
Fait rare qui montre la gravité de la situation, le PDG de Google, Sundar Pichai, a décidé de témoigner en personne devant le tribunal. Ce choix révèle l’importance vitale de ce procès pour l’avenir de l’entreprise qu’il dirige depuis 2015.
Dans son témoignage, Pichai insistera probablement sur les sommes investies par Google dans le développement et la sécurité de ses produits. Il défendra l’idée qu’un démantèlement nuirait non seulement aux utilisateurs mais aussi à tout un réseau d’entreprises qui s’appuient sur ses technologies.
Les concessions calculées : le plan B de Google
Conscient des risques, Google a déjà préparé plusieurs alternatives pour éviter les sanctions les plus dures. Dès décembre dernier, l’entreprise a présenté un plan limitant à un an la durée des contrats avec les navigateurs web, un changement notable pour une société habituée à des accords de plusieurs années.
Google se dit aussi prêt à ne plus exiger des fabricants de smartphones un contrat d’exclusivité pour son moteur de recherche en échange de la pré-installation de son magasin d’applications. Pour son IA Gemini, l’entreprise promet de ne pas reproduire le modèle d’exclusivité qui lui est aujourd’hui reproché.
Plus fondamentalement, Google tente de persuader le juge Mehta qu’elle seule peut assurer la maintenance et la sécurité du code utilisé par Chrome – code dont dépendent aussi d’autres navigateurs comme Firefox, Edge ou Opera. Un argument technique qui pourrait influencer la décision finale.
Au-delà de Google : les conséquences pour tous
L’effet sur les autres géants tech
La décision du tribunal aura des répercussions bien au-delà de Google. Elle créera un précédent juridique majeur qui pourrait toucher tous les géants américains de la technologie. Meta, Amazon et Apple suivent les procédures avec attention, sachant que leurs propres pratiques commerciales pourraient bientôt être examinées selon les mêmes critères.
Si le juge Mehta ordonne le démantèlement partiel de Google, cela pourrait pousser les régulateurs à adopter une approche similaire avec d’autres entreprises en position dominante sur leurs marchés. La Silicon Valley entière retient son souffle, car cette décision pourrait marquer la fin d’une période d’expansion sans limites.
Le paradoxe de la concurrence : quand les rivaux dépendent de Google
Au-delà des grandes entreprises, ce sont aussi les nombreux partenaires de Google qui s’inquiètent des conséquences possibles. Mozilla, créateur du navigateur Firefox, tire une part importante de ses revenus – estimée à plusieurs centaines de millions de dollars – des contrats passés avec Google pour faire de son moteur de recherche l’option par défaut.
Si ces accords sont interdits ou fortement restreints, c’est tout un ensemble de petites et moyennes entreprises qui pourrait se retrouver en difficulté. Paradoxalement, des mesures visant à restaurer la concurrence pourraient menacer l’existence même de certains concurrents de Google.
Et après ?
Imaginer un monde où Chrome et Android seraient séparés de Google soulève de nombreuses questions. Comment ces produits évolueraient-ils sans le soutien financier et technique du géant de Mountain View ? Quelles seraient les conséquences pour les centaines de millions de personnes qui utilisent ces services chaque jour ?
Pour Chrome, une vente forcée pourrait théoriquement mener à une diversification des moteurs de recherche proposés. Pour Android, cela pourrait signifier la fin de l’obligation pour les fabricants d’installer les applications Google, ouvrant peut-être la voie à un marché mobile plus varié.
Mais ces changements s’accompagneraient aussi de difficultés considérables en termes de compatibilité, de sécurité et d’expérience utilisateur. Les consommateurs gagneraient-ils vraiment à une fragmentation accrue du marché ? La question reste ouverte et constitue l’un des aspects les plus délicats que le juge Mehta devra trancher.