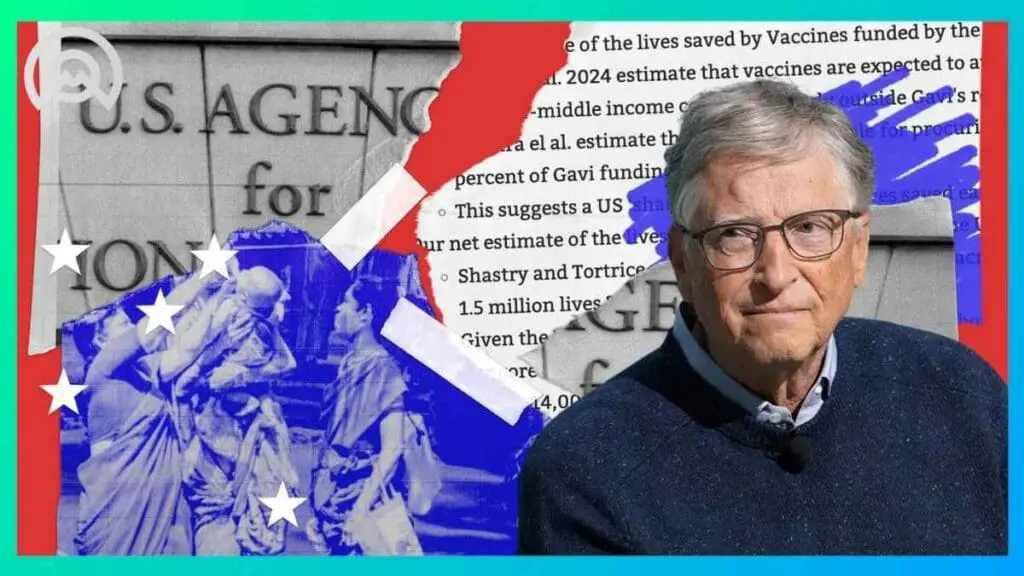Découvrez comment le Revenu Minimum Étudiant, proposé par certaines communes, peut révolutionner la vie financière de votre enfant étudiant. Entre 100 et 2000 euros par an, cette aide locale pourrait bien être la solution à leurs difficultés budgétaires.
Résumé :
- Le RME est une aide financière locale pour les étudiants en situation précaire
- Proposé par une quinzaine de communes en France
- Montants variables selon les villes, allant de 100 à 2000 euros par an
- Critères d’éligibilité : statut étudiant, âge, domiciliation, ressources
- Peut être cumulé avec d’autres aides comme les bourses d’État
Dans un contexte où le coût de la vie étudiante ne cesse d’augmenter, une aide méconnue pourrait bien changer la donne pour de nombreux jeunes en difficulté financière. Le Revenu Minimum Étudiant (RME), une initiative locale mise en place par certaines communes, offre un soutien financier précieux aux étudiants les plus modestes. Cette aide, qui peut atteindre jusqu’à 2000 euros par an, reste pourtant dans l’ombre des dispositifs nationaux.
Créé en 1989 par Roland Carraz, alors maire de Chenôve en Côte-d’Or, le RME s’est peu à peu étendu à d’autres communes, apportant un complément bienvenu aux bourses d’État et autres aides existantes. Mais comment fonctionne exactement ce dispositif ? Quels sont les critères d’éligibilité et les démarches à entreprendre ? Plongeons dans les détails de cette aide qui pourrait bien soulager le budget de votre enfant étudiant.
1. Qu’est-ce que le Revenu Minimum Étudiant ?
Le Revenu Minimum Étudiant (RME) est une aide financière locale destinée aux étudiants en situation de précarité. Contrairement aux dispositifs nationaux comme les bourses sur critères sociaux, le RME est une initiative mise en place par certaines communes pour soutenir leurs jeunes résidents poursuivant des études supérieures.
L’objectif principal du RME est de permettre aux étudiants issus de familles modestes de financer une partie de leurs besoins quotidiens. Cela peut inclure l’achat de livres, d’un ordinateur, ou simplement couvrir les frais de la vie courante. Cette aide vient donc en complément d’autres dispositifs existants, formant un filet de sécurité financière pour les étudiants les plus vulnérables.
L’histoire du RME remonte à 1989, lorsque Roland Carraz, alors maire de Chenôve en Côte-d’Or, a mis en place ce dispositif innovant. Depuis, l’idée a fait son chemin et a été adoptée par d’autres communes soucieuses d’apporter un soutien concret à leur jeunesse estudiantine. Bien que le RME ne soit pas généralisé à l’ensemble du territoire français, il représente une ressource précieuse pour les étudiants des villes qui le proposent.
2. Quels sont les critères d’éligibilité au RME ?
L’accès au Revenu Minimum Étudiant est soumis à plusieurs critères qui peuvent varier selon les communes. Cependant, certaines conditions sont généralement communes à l’ensemble des dispositifs :
- Statut étudiant : Le premier critère, et le plus évident, est d’être étudiant. Un justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur est systématiquement demandé.
- Âge : La plupart des communes fixent une limite d’âge pour bénéficier du RME. Généralement, les étudiants doivent avoir entre 18 et 25 ans, bien que certaines villes étendent cette limite jusqu’à 26 ou 27 ans.
- Lieu de résidence : Le RME étant une aide locale, les bénéficiaires doivent justifier d’une domiciliation dans la commune qui propose l’aide. Certaines villes vont plus loin en exigeant une durée minimale de résidence. Par exemple, Chenôve demande deux années de résidence principale des parents dans la commune, tandis que Grande-Synthe et Longwy exigent trois années.
- Ressources financières : Le RME est destiné aux étudiants issus de familles modestes. Les communes fixent généralement un plafond de ressources ou un quotient familial maximum. Si l’étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents, ce sont leurs revenus qui sont pris en compte.
- Parcours scolaire : Certaines communes prennent en compte le parcours académique de l’étudiant. Par exemple, une demande peut être refusée si l’étudiant redouble pour la troisième fois la même année d’études.
Il est important de noter que ces critères peuvent varier d’une ville à l’autre. Il est donc crucial de se renseigner auprès de sa mairie ou du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour connaître les conditions spécifiques d’attribution du RME dans sa commune.
3. Quelles communes proposent le RME ?
Le Revenu Minimum Étudiant n’est pas un dispositif national, ce qui explique qu’il soit méconnu de nombreux étudiants et parents. À ce jour, seule une quinzaine de communes en France proposent cette aide. Voici une liste non exhaustive des villes participantes :
- Berre l’Étang (Bouches-du-Rhône)
- Cerizay (Deux-Sèvres)
- Champagne au Mont d’Or (Rhône)
- Genay (Rhône)
- Chenôve (Côte-d’Or)
- Dunkerque (Nord)
- Grande-Synthe (Nord)
- Gravelines (Nord)
- Longwy (Meurthe-et-Moselle)
- Nogent-sur-Seine (Aube)
- Saint-André-les-Vergers (Aube)
- Petit-Couronne (Seine-Maritime)
- Le Petit-Quevilly (Seine-Maritime)
- Plougastel-Daoulas (Finistère)
- Montbard (Côte-d’Or)
- Panazol (Haute-Vienne)
Il est important de noter que certaines collectivités proposent des aides similaires sous des noms différents. Par exemple, les villes de Dijon (Côte-d’Or) et de Cholet (Maine-et-Loire) offrent des « Bourses étudiantes » qui s’apparentent au RME.
Si votre commune ne figure pas dans cette liste, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie. De nouvelles villes pourraient avoir mis en place ce dispositif récemment. De plus, votre démarche pourrait encourager votre municipalité à envisager la création d’une telle aide.
4. Quel est le montant de l’aide et comment est-elle versée ?
L’un des aspects les plus variables du Revenu Minimum Étudiant est son montant. Chaque commune détermine librement la somme allouée aux étudiants bénéficiaires, ce qui peut créer des différences significatives d’une ville à l’autre.
Les montants du RME peuvent aller de 100 euros à près de 2000 euros par an, selon les communes et les situations individuelles. Voici quelques exemples :
- À Champagne au Mont d’Or, le RME oscille entre 300 et 850 euros par an. Les étudiants dont les ressources dépassent légèrement le plafond peuvent tout de même bénéficier d’une aide comprise entre 100 et 150 euros.
- À Berre l’Étang, le montant peut atteindre 2000 euros par an pour les étudiants éligibles.
- À Montbard, l’aide peut aller jusqu’à 1200 euros, versés en deux fois au cours de l’année universitaire.
Le mode de calcul du RME varie également selon les communes :
- Certaines villes, comme Berre l’Étang, versent une somme forfaitaire identique à tous les bénéficiaires.
- D’autres, comme Plougastel-Daoulas et Petite-Couronne, calculent le montant de l’aide en fonction des ressources de l’étudiant et de sa famille.
Quant aux modalités de versement, elles diffèrent aussi d’une commune à l’autre :
- Certaines optent pour un versement mensuel, à l’instar des bourses d’État.
- D’autres préfèrent un versement en une ou plusieurs fois au cours de l’année universitaire.
Il est important de noter que le RME peut être cumulé avec d’autres aides, notamment les bourses d’État sur critères sociaux. Cela peut représenter un complément financier non négligeable pour les étudiants les plus précaires.
Revenu minimum étudiant: la ville du Petit-Quevilly (Seine-Maritime) met en place une aide de 100 euros par mois à partir de septembre pic.twitter.com/2EUXOXWEdL
— BFM Normandie (@BFM_Normandie) August 5, 2024
5. Quelles sont les contreparties demandées ?
Si le Revenu Minimum Étudiant est avant tout une aide financière, certaines communes y associent des contreparties. Ces dernières visent généralement à encourager l’engagement citoyen des étudiants bénéficiaires et à créer un lien entre eux et leur commune de résidence.
Les contreparties les plus courantes sont :
- Actions citoyennes : Par exemple, à Champagne au Mont d’Or, les bénéficiaires du RME doivent réaliser une action citoyenne de 4 heures au cours de l’année. Cela peut impliquer une participation à des événements locaux comme le forum des associations, le marché de Noël ou encore l’aide lors des élections.
- Engagement associatif : À Longwy, les étudiants bénéficiant du RME doivent s’engager auprès d’une association locale pour une durée de 15 heures.
- Assiduité aux cours et examens : Bien que ce ne soit pas à proprement parler une contrepartie, la plupart des communes exigent que les bénéficiaires du RME soient assidus en cours et se présentent à tous leurs examens. Un certificat de suivi de scolarité est souvent demandé en cours d’année pour s’assurer que l’étudiant n’a pas abandonné ses études.
- Résultats académiques : Certaines communes prennent en compte le parcours scolaire de l’étudiant. Par exemple, une demande de renouvellement du RME peut être refusée si l’étudiant redouble pour la troisième fois la même année d’études.
Ces contreparties, bien que parfois perçues comme contraignantes, ont plusieurs objectifs :
- Encourager l’implication des jeunes dans la vie locale
- Favoriser le développement de compétences et d’expériences valorisables
- Assurer une utilisation responsable de l’aide financière
Il est important de noter que ces contreparties varient selon les communes. Certaines villes peuvent ne pas en exiger du tout, tandis que d’autres peuvent avoir des demandes spécifiques. Il est donc essentiel de se renseigner auprès de sa mairie pour connaître les conditions exactes d’attribution et de maintien du RME.
6. Comment faire la demande de RME ?
La procédure pour demander le Revenu Minimum Étudiant peut varier d’une commune à l’autre, mais elle suit généralement les étapes suivantes :
- Se renseigner : La première étape consiste à vérifier si votre commune propose le RME. Contactez votre mairie ou le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour obtenir des informations sur le dispositif et les conditions d’éligibilité.
- Obtenir le dossier de demande : Chaque commune dispose de son propre formulaire. Il peut être disponible en ligne sur le site de la mairie ou à retirer directement auprès des services municipaux.
- Rassembler les documents nécessaires : Les pièces justificatives généralement demandées incluent :
- Pièce d’identité et photo récente
- Certificat de scolarité et carte étudiant
- Avis d’imposition de l’étudiant et de ses parents
- Notification de bourse d’État (le cas échéant)
- Justificatif de domicile
- Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
- Remplir le dossier : Complétez soigneusement le formulaire en veillant à fournir toutes les informations demandées.
- Déposer la demande : Remettez votre dossier complet à la mairie ou au CCAS avant la date limite de dépôt. Cette date varie selon les communes, mais se situe généralement en début d’année universitaire.
- Suivi de la demande : Après le dépôt, votre dossier sera examiné par les services compétents. N’hésitez pas à demander un récépissé de dépôt et à vous renseigner sur les délais de traitement.
- Réponse et versement : Si votre demande est acceptée, vous serez informé des modalités de versement de l’aide.
Il est important de noter que le RME n’est généralement pas automatiquement renouvelé d’une année sur l’autre. Vous devrez donc refaire une demande chaque année si vous souhaitez continuer à en bénéficier.
Enfin, n’oubliez pas que le RME est une aide complémentaire. Il est recommandé de faire également les demandes pour d’autres aides auxquelles vous pourriez avoir droit, comme les bourses sur critères sociaux, les aides au logement, etc.